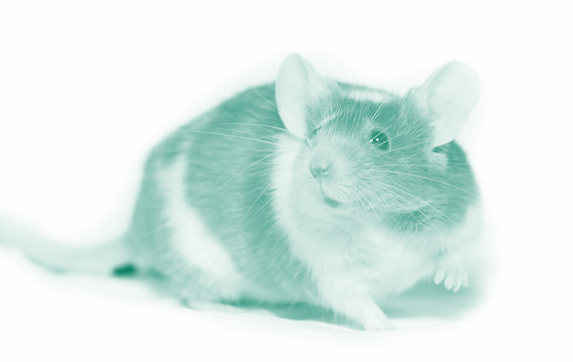Peut-on souffrir de prendre soin ? Près de neuf personnes sur dix travaillant dans les animaleries des labos de recherche ont connu un épisode de “fatigue compassionnelle” au cours de leur carrière, révélait une étude publiée en 2021. Stress, épuisement, voire burn-out, qui peut s’accompagner d’une perte de l’empathie ou de l’apparition des mêmes symptômes que ceux dont ils s’occupent, le phénomène, bien connu dans le milieu de la santé, est pris en compte récemment dans le monde vétérinaire avec une augmentation des cas de suicides et, toutes proportions gardées, dans la petite communauté de l’expérimentation animale.
« Avoir des souris de laboratoire, c’est comme avoir des animaux de compagnie : il faut aller à l’animalerie s’en occuper quotidiennement »
Éric Muraille
En première ligne. Cette fatigue est d’abord physique : travailler dans une animalerie n’est pas une sinécure. Les personnels doivent souvent porter une tenue spécifique, rester dans des pièces parfois sans lumière naturelle, transporter les cages parfois lourdes et subir les odeurs à longueur de journée… Le métier est dur et beaucoup développent des allergies aux rongeurs, les obligeant à porter un masque en présence des animaux. La plupart du temps, ce sont elles – la profession est très féminisée – qui s’occupent au quotidien des animaux dans des plateformes mutualisées. Mais certains chercheurs, principalement pour des raisons financières, font eux-mêmes le travail. C’est le cas d’Éric Muraille, chercheur en immunologie à l’Université Libre de Bruxelles.
Recherche oblige. « Certains militants de la cause animale pensent que nous choisissons l’expérimentation animale car elle coûte moins chère que l’in vitro. C’est totalement faux. » Eric Muraille a observé une explosion des coûts dans les animaleries. Si les gros labos peuvent continuer à payer la gestion des animaux et les services associés à l’animalerie, les petites équipes comme la sienne doivent faire des choix. Lui et ses étudiants s’occupent de tout – change et sexage des souris –, achetant uniquement la nourriture et la litière à l’animalerie. « Cela me revient à environ 6 000 euros par an, alors que je paierais près de 35 000 euros pour le service complet »
« Tuer n’est jamais anodin, c’est le geste le plus difficile dans nos métiers »
Armelle Rancillac
Sept sur sept. Dans l’expérimentation animale, les pauses n’existent pas : « Avoir des souris de laboratoire, c’est comme avoir des animaux de compagnie : il faut aller à l’animalerie s’en occuper quotidiennement, même le jour où il y a une tempête de neige ou qu’un confinement est décrété… On peut difficilement partir en vacances ; cela fait presque 30 ans que je n’arrête pas », témoigne-t-il. Il faut également anticiper les cycles de reproduction, tout planifier plusieurs mois à l’avance : « C’est la chose la plus compliquée dans ma vie de chercheur », témoigne l’immunologiste, qui a lui aussi développé une allergie.
Mort imminente. La fatigue est aussi morale. Les animaliers et les quelques chercheurs qui s’occupent eux-mêmes des animaux les élèvent de leur naissance jusqu’à leur mort. Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences au Collège de France, a travaillé avec des modèles animaux dès sa thèse, analysant « des tranches de cerveau vivant » : « Tuer n’est jamais anodin, c’est le geste le plus difficile dans nos métiers ». Et qui peut marquer à vie : « Les traumatismes proviennent souvent d’une situation bien particulière – une euthanasie par exemple –, qui remonte parfois pour les chercheurs au doctorat », explique Dominique Autier-Dérian, vétérinaire désignée pour plusieurs établissements de recherche en tant que consultante en bien-être animal.
« On l’oublie souvent mais les zootechniciens ont choisi cette voix avant tout car ils aiment les animaux. Ils font preuve d’empathie envers eux et possèdent la culture du soin »
Brigitte Rault
Détresse partagée. Pour Armelle Rancillac, ne pas créer de stress pour l’animal avant le geste fatidique a un double enjeu : par éthique mais aussi pour la qualité des données. « Avec l’expérience, on a moins d’appréhension et on fait le geste avec plus d’assurance, ce qui est aussi mieux pour l’animal », témoigne la neurologue. Mais les scientifiques doivent aussi parfois supporter de voir souffrir les animaux pour le bien de la science. Éric Muraille étudie deux modèles d’infection, dont une bactérie qui entraîne une forte réponse inflammatoire pulmonaire, plongeant les souris dans une détresse respiratoire : « Deux jours à observer heure par heure des souris dont certaines souffrent, ce n’est franchement pas agréable pour nous ».
Dans la même barque. Mais « de manière générale, les chercheurs sont moins impactés que les personnels au contact quotidien avec les animaux et n’ont pas tous conscience de l’impact de la fatigue compassionnelle sur les personnels des animaleries », témoigne Dominique Autier-Dérian. « On l’oublie souvent mais les zootechniciens ont choisi cette voix avant tout car ils aiment les animaux. Ils font preuve d’empathie envers eux et possèdent la culture du soin », explique Brigitte Rault, vétérinaire de formation qui est entrée à l’Inserm pour accompagner la recherche animale en tant que référente éthique et modèle animaux. Même son de cloche de la part de Dominique Autier-Dérian : « On ne devient pas vétérinaire ni soigneur par hasard – c’est qu’on aime les animaux. ».
« Comme nous sommes assez “speed”, notre attitude peut parfois être interprétée comme du dédain [envers les animaliers] »
Armelle Rancillac
Tous ensemble. Le coût émotionnel est d’autant plus lourd pour les animaliers : « S’occuper d’un animal dont l’issue sera le plus souvent l’euthanasie est encore plus éprouvant si on ne sait pas pourquoi on le fait », explique Brigitte Rault. Si la finalité des études sur les animaux est évidente pour les chercheurs qui publient les résultats et recueillent les lauriers, elle l’est parfois beaucoup moins pour les étudiants ou les techniciens qui participent aux études, parfois frustrés du manque de reconnaissance. C’est le fond du problème, selon Armelle Rancillac : « Nous chercheurs sommes très contents et reconnaissants du travail que les animaliers font, mais comme nous sommes assez “speed”, notre attitude peut parfois être interprétée comme du dédain. » Elle et ses collègues leur communiquent les publications ou ils sont remerciés, mais ces dernières sont en anglais et souvent très techniques, donc difficilement appréhendables pour les animaliers. Dominique Autier-Dérian propose d’aller plus loin : « Les associer d’avantage, par exemple dans l’évaluation de la gravité prospective des procédures expérimentales dans les dossiers soumis au comité d’éthique [obligatoires avant chaque étude impliquant des animaux, NDLR], peut être une manière de mieux prendre en compte ce qu’ils ressentent, et donc limiter le risque lié à l’émergence d’une fatigue compassionnelle ». Évaluer en plus l’impact humain sur les personnels serait également un pas en avant.
Nouveaux maux. « Avec la fatigue compassionnelle, on a mis un mot sur quelque chose qui existait déjà depuis longtemps », analyse Ivan Balansard, vétérinaire, responsable du bureau éthique et modèles animaux du CNRS, mais aussi président du Gircor. Si le phénomène est commun à toutes les professions du soin, la particularité de l’expérimentation animale est selon lui le regard souvent biaisé de la société. La stigmatisation générée par les militants animalistes entraîne un sentiment d’injustice chez les personnels des animaleries : « Il existe un décalage profond entre l’image qu’ils ont de leur travail et celle que leur renvoient certaines associations animalistes : celle de bourreau, opposée à leur quotidien ».
« Chaque nouvel entrant au labo doit passer deux jours complets à l’animalerie »
Armelle Rancillac
Victimes, aussi. « On nous accuse souvent de maltraitance animale », affirme Éric Muraille en référence aux communications des militants anti-expérimentation animale qui polarisent selon lui l’opinion. Quelques scandales ont marqué les esprits en Belgique, notamment l’opération d’infiltration de l’association Gaia à l’Université libre néerlandophone de Bruxelles en 2016. Ses révélations d’images prises en caméra cachée ont entraîné des menaces sur des chercheurs et même à une alerte à la bombe sur le campus. « À ces occasions, les chercheurs rasent les murs, n’osent pas dire qu’ils travaillent avec des animaux. Et pour les étudiants, c’est encore plus difficile ».
Consentement éclairé. Ainsi quand des étudiants envisagent de faire un stage chez eux, Armelle Rancillac et ses collègues abordent très vite la question des animaux. Ils travaillent donc en connaissance de cause. « Chaque nouvel entrant au labo doit passer deux jours complets à l’animalerie, ce qui leur permet entre autres de se rendre compte de la réalité du travail. Il faut aussi passer l’habilitation à l’expérimentation animale niveau 1, une formation de deux semaines agréée par le ministère pour pouvoir manipuler des animaux, voire même une autre formation à la chirurgie, d’une semaine, si les expérimentations le nécessitent. »
« Plus on s’implique sur la réflexion éthique, moins on est impacté par la fatigue compassionnelle »
Dominique Autier
Du recul. « Les formations à la question de la fatigue compassionnelle peuvent permettent aux personnels d’identifier chez eux-mêmes des symptômes liés à cet état », explique Dominique Autier-Dérian. Comment en atténuer les impacts ? En limitant les heures, en instaurant des pauses régulières mais aussi des relations de confiance avec les supérieurs hiérarchiques et les collègues : « Plus on s’implique sur la réflexion éthique, moins on est impacté par la fatigue compassionnelle. Les décisions ne sont plus vécues comme imposées et l’on sait qu’on fait du mieux possible pour l’animal ». Pour réduire ou empêcher la fatigue compassionnelles, il est conseillé d’avoir une activité physique régulière, des loisirs de bien dormir… Bref, tous les mécanismes de récupération du stress sont utiles. « Avoir des animaux chez soi pour se prouver qu’on peut s’en occuper de manière optimale » peut aussi aider.
Foin du mutisme. Il n’existe à l’heure actuelle pas de suivi psychologique systématique des personnels (techniciens, ingénieurs ou chercheurs) travaillant au contact des animaux : « On parle de bien-être animal mais on est peut-être plus en retard sur le bien-être psychique des personnels », ironise Armelle Rancillac. Si les personnels travaillant au contact des animaux sont suivis par la médecine du travail en termes de troubles musculo-squelettiques et d’allergie, un vide subsiste au niveau de la prise en charge de la santé mentale. Faut-il développer un service d’écoute ? Pour Brigitte Rault, « la parole doit se libérer ».
« Le malaise persiste, avec la crainte que les propos soient mal interprétés »
Brigitte Rault
Contre-attaque. « Il y a une dizaine d’années s’est opéré un changement de paradigme, explique Ivan Balansard. L’omerta des établissements de recherche, porte ouverte à tous les fantasmes sur l’expérimentation animale, a cédé la place à plus de transparence ». Notamment grâce au Gircor, une association regroupant des acteurs publics et privés de la recherche et de l’enseignement supérieur. Ce dernier « ne fait pas de prosélytisme mais amène de l’information et de la contradiction dans les médias face aux militants anti-expérimentation animale », explique le vétérinaire du CNRS, également président du Gircor. Malgré tout, parler de son travail avec l’animal reste compliqué dans la sphère familiale ou sociale, comme le rappelait l’Inserm en 2018. « Le malaise persiste, avec la crainte que les propos soient mal interprétés », témoigne Brigitte Rault. Expliquer à ses proches et justifier l’expérimentation animale est souvent plus facile pour les chercheurs qui peuvent s’appuyer sur leurs résultats scientifiques que pour les zootechniciens, qui sont pourtant « des personnes essentielles dans le processus de recherche, mais moins visibles ».