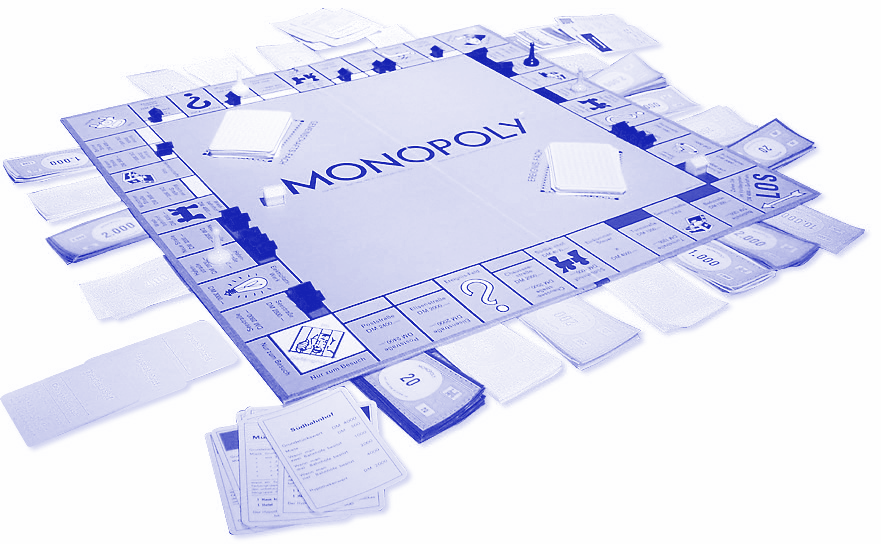Imaginez la scène : un tribunal plein à craquer dans lequel s’affrontent universitaires et grandes maisons d’édition de revues scientifiques. Cette scène pourrait arriver plus vite que prévu de l’autre côté de l’Atlantique. Le 12 septembre dernier, Lucinda Udiff, professeur de neurosciences à l’Université de Californie à Los Angeles, a déposé une plainte “antitrust”au nom d’un collectif à l’encontre de six éditeurs, les accusant « d’entente dans le but de s’approprier illégalement des milliards de dollars qui auraient autrement financé la recherche scientifique », peut-on lire sur le communiqué du cabinet d’avocats Lieff Cabraser en charge de l’affaire. « C’est un recours collectif qui se fait au nom de tous les scientifiques ayant fourni des manuscrits ou une activité de peer-reviewing pour les éditeurs en question », précise l’avocat Dean Harvey, qui s’exprime en lieu et place de Lucinda Udiff dans cette affaire plus que sensible. Car le banc des accusés est bien garni puisqu’il réunit rien moins qu’Elsevier, Wolters Kluwer, John Wiley & Sons, Sage Publications, Taylor and Francis ainsi que Springer Nature. Les six détenant à eux seuls 53% des revues académiques. L’objectif de la procédure : les mettre face à leurs pratiques jugées déloyales.
« [Les éditeurs se sont entendus pour] retenir en otage les carrières des chercheurs »
Extrait de la plainte du collectif
Jamais deux sans trois. Accusés d’enfreindre les lois antitrust américaines — censées préserver la concurrence — les six géants de l’édition scientifique auraient ainsi créé « un ensemble de règles pour consolider la position dominante des éditeurs sur le marché et maximiser la quantité d’argent qu’ils peuvent se mettre dans la poche ». Que leur est-il concrètement reproché ? Le dossier déposé au tribunal de New York — accessible en ligne — fait mention de trois doléances. La première accuse les éditeurs de s’être entendus pour avoir rendu le peer-reviewing gratuit. Avec une récompense pour ce travail gratuit des reviewers : faciliter la publication de leurs propres articles au sein de la même revue. Autrement dit : « [ils se sont entendus pour] retenir en otage les carrières des chercheurs », résume sans détours la plainte. La seconde souligne la mise en place d’une règle commune exigeant des chercheurs qu’ils ne soumettent leurs manuscrits qu’à une seule revue à la fois, obérant ainsi la concurrence. Et enfin, une troisième dénonce l’interdiction qu’ont les chercheurs de partager librement les manuscrits soumis tant que ces derniers en sont à l’étape du peer-review (bien que de nombreux chercheurs ne se gênent pas pour le faire quand même avec les preprints) . « Ils se comportent comme si les avancées scientifiques décrites dans les manuscrits étaient leur propriété, pour ensuite facturer au maximum […] l’accès à ces connaissances », soulignent les plaignants.
« [Nous sommes] très attaché à soutenir la communauté académique »
Wiley
Publitrafiquants. Car oui, s’il faut encore le rappeler, ce business est plus que lucratif. Pour l’année 2024, la plainte mentionne un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars pour les six éditeurs combinés avec des marges dépassant celles d’Apple ou de Google — ce qui a d’ailleurs fait réagir sur X. « Les éditeurs ont formé un cartel par l’intermédiaire de l’organisation STM [l’Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux, aussi sur le banc des accusés, NDLR] et fixé des règles de conduite pour conserver leur mainmise sur le marché », nous explique Dean Harvey. Des principes publiés dès la création de l’association sous le nom International Ethical Principles for Scholarly Publication et que tous ses membres « se sont engagés à respecter », peut-on lire dans la plainte. « Dans ce genre d’affaires, il est rare d’avoir des preuves à disposition, nous avons donc bon espoir de pouvoir prouver leur faute », ajoute Dean Harvey. De quoi bousculer ces éditeurs qui règnent sur le monde de la publication scientifique depuis des décennies ? Contactés par nos soins, aucun d’entre eux n’a souhaité s’exprimer sur cette affaire. Seul un porte-parole de Wiley a tenu à préciser qu’ils considéraient que les plaintes étaient « sans aucun fondement » et que Wiley restait « très attaché à soutenir la communauté académique en délivrant l’excellence dans tous les aspects de la publication académique ».
« Si les chercheurs pouvaient proposer leurs articles à plusieurs revues à la fois, (…) cela changerait complètement la donne »
Björn Brembs
Rebelotte. Bien que les initiatives pour tenter d’entraver leur hégémonie soient de plus en plus nombreuses, l’initiative est inédite selon Dean Harvey : « À notre connaissance, c’est la première fois que ces arguments sont utilisés dans un procès contre ces éditeurs ». Une organisation allemande représentant les petits éditeurs avait elle aussi déposé une plainte auprès des organismes de surveillance antitrust du pays en 2019 suite aux négociations du projet DEAL — équivalent allemand du consortium Couperin — avec les grands éditeurs. « Leur argument : les négociations avec ces grands éditeurs se font au détriment des plus petits », explique Björn Brembs, chercheur en neurobiologie impliqué dans l’open science depuis 2008. Mais la plainte n’avait pas abouti. Pour le neuroscientifique, ce nouveau procès apporte un point de vue « très original », qui n’est « pas sans risque » pour les éditeurs.
Araignée du soir… « Tout dépend des arguments retenus lors du procès », poursuit Björn Brembs. À ses yeux, payer les reviewers ne permettrait pas de renverser l’ordre établi et ne pourrait être qu’un argument supplémentaire pour augmenter le prix des revues. Il retient en revanche un autre argument : « Si les chercheurs pouvaient proposer leurs articles à plusieurs revues à la fois, les éditeurs ne produiraient plus du contenu mais des services, ce qui changerait complètement la donne », explique-t-il. Le chercheur se range donc du côté des plaignants pour dire que ce monopole est l’une des principales racines du problème. « C’est la raison pour laquelle les experts et le conseil de l’Union Européenne disent que ces revues doivent être remplacées par autre chose qui empêcherait ce verrouillage », complète-t-il. Ce qui signifie donc remettre en cause tout un système de publication et d’évaluation dans lequel ces revues sont encore considérées comme les plus prestigieuses. « Et pour cela, il faudrait que tout l’écosystème réagisse », explique Björn Brembs. « Les choses changeront difficilement s’il n’y a qu’un pays ou qu’une université à passer la cap. »
« Si nous parvenons faire respecter les lois de la concurrence aux États-Unis, je vois mal comment les éditeurs pourraient ne pas les faire appliquer en Europe »
Dean Harvey, avocat des plaignants
…Espoir ? Quoi qu’il en soit, la machine judiciaire est lancée. Les éditeurs peuvent actuellement œuvrer pour que la plainte soit rejetée, mais le cas échéant cette dernière pourrait bien les amener au tribunal d’ici deux ou trois ans. Qu’encourent-ils exactement ? D’une part, une amende calculée au prorata du travail impayé de tous les chercheurs étatsuniens concernés — « au moins 100 000 », clarifie Dean Harvey — et qui leur serait ensuite reversée. D’autre part, la reconnaissance du caractère illégal des accords passés par le « cartel d’éditeurs »… qui mènerait donc à leur dissolution. « Avec l’espoir que cela rende le marché plus compétitif », complète Dean Harvey : « Si nous parvenons à obtenir ce respect des lois de la concurrence aux États-Unis, je vois mal comment les éditeurs pourraient ne pas faire de même en Europe ».