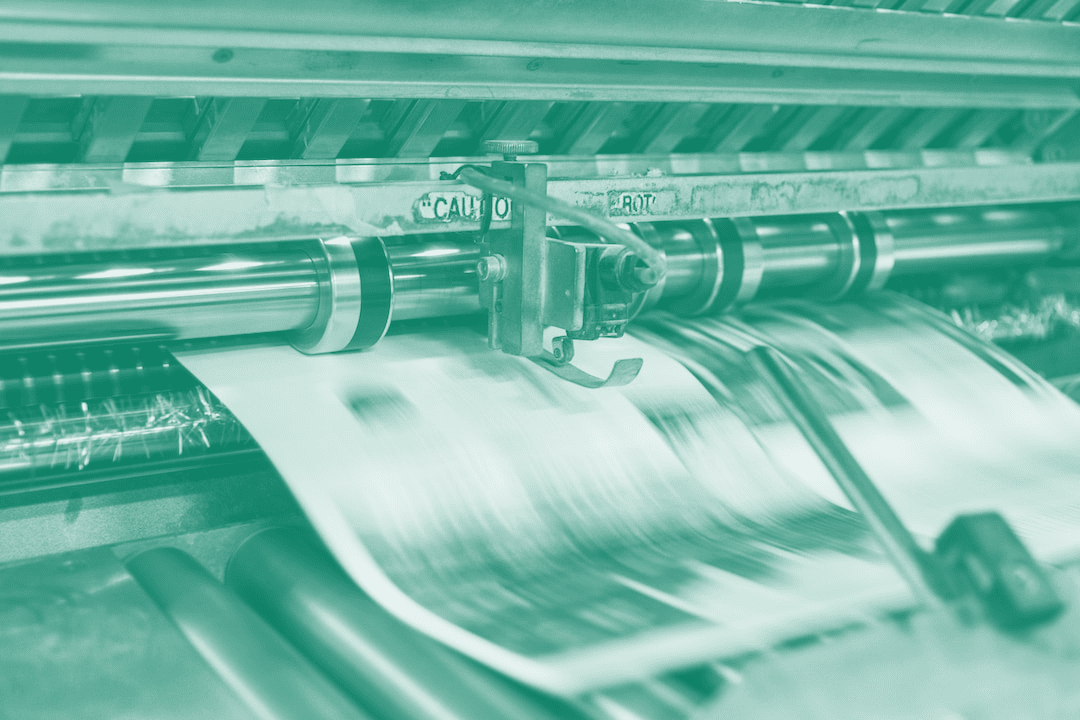Vlam. Une quarantaine de chercheurs, tous éditeurs au sein de la relativement prestigieuse revue NeuroImage, viennent de claquer la porte de la maison Elsevier et ont annoncé travailler à la création d’une revue de remplacement, cette fois-ci en accès ouvert et à but non lucratif. Estimant le coût d’une publication à moins de 1000 dollars, ils ne comprenaient pas le refus du géant de l’édition scientifique de baisser les frais de publication, s’élevant à près de 3500 dollars. Un mouvement d’humeur qui illustre la volonté d’une reprise en main des revues par certains chercheurs, qui sourd depuis quelques dizaines années au sein des communautés académiques.
« Nous voulions montrer aux collègues que cela existe et fonctionne »
Benoît Claudon
Tous ensemble, hé. Si au siècle dernier, les chercheurs dépendaient cruellement des maisons d’édition pour diffuser leurs résultats via de beaux volumes reliés – quelques-uns décorent certainement la salle de réunion de votre labo –, le numérique a considérablement changé la donne. Quoi de plus simple en effet que de déposer son preprint en ligne et d’en faire la publicité sur les réseaux sociaux ? Aujourd’hui, beaucoup de chercheurs estiment que les grands “publishers” – Springer Nature, Elsevier… – font du profit sur leur dos, prenant leurs résultats, leur demandant d’évaluer gratuitement ceux de leurs collègues, pour au final faire en payer de plus en plus cher l’accès… et de plus en plus aux auteurs. En quatre ans et à l’échelle mondiale, les chercheurs auraient payé plus d’un milliard de dollars pour publier, la France étant en 9ème position avec un coût des APC multiplié par trois entre 2013 et 2020. Une injustice particulièrement ressentie par les scientifiques de pays “institutionnellement pauvres”, n’ayant pas les moyens de publier dans les revues les plus prestigieuses.
Un peu d’histoire. Émerge alors à la fin des années 1990 l’idée de reprendre la main et de s’affranchir des maisons d’édition. Déposer ses manuscrits sous la forme de preprint est une habitude déjà bien ancrée dans certaines communautés comme en maths ou en physique. La création d’arXiv aux États-Unis en 1991 inspire celle de HAL en France dix ans plus tard – relire notre interview de son créateur Franck Laloë. Il ne manque finalement plus qu’une évaluation par les pairs afin de transformer ces preprints en vraies publications scientifiques. Notamment sous l’impulsion de Jean-Pierre Demailly, mathématicien à l’Institut Fourier, l’idée d’ajouter une couche de reviewing juste au-dessus du dépôt de preprint donne lieu à la naissance des overlay journals pour les anglophones, épirevues pour les francophiles, ainsi que d’une plateforme pour les héberger, Episciences. Cette dernière est financée par des deniers publics en lien avec la politique de science ouverte ; elle a fêté ses dix ans célébrés lors d’une conférence fin mars à Lyon.
« Nous voulions un journal indépendant géré par la communauté car nous avions eu de mauvaises expériences avec les éditeurs commerciaux »
Jens Gustedt
Fonds baptismaux. À partir des années 2010, Episciences commence à héberger ses premières revues, principalement en mathématiques et informatiques, soit des créations, soit des revues “exflitrées” de petites maisons d’édition. C’est le cas de Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, créée en 1998 et plutôt bien installée à travers les communautés de maths et d’informatique théorique. Suite à la faillite de la maison d’édition, les chercheurs de son comité éditorial se sont retrouvés avec la revue sur les bras et ont décidé d’en créer une en open. Avec quelques convictions : « Nous voulions un journal indépendant géré par la communauté, nous avions eu de mauvaises expériences avec les éditeurs commerciaux. Leur objectif est de faire du chiffre d’affaires et non celui de travailler dans l’intérêt de la communauté scientifique », explique Jens Gustedt, un des éditeurs en chef de la revue.
Revues disciplinées. En 2013, la création du Journal of Data Mining and Digital Humanities, cofondé par Laurent Romary avec deux collègues, l’un à l’époque à l’Inra, l’autre en Australie, correspond à l’apparition d’une nouvelle communauté de recherche, celle des Humanités numériques. « À l’époque, voyant l’apparition de plusieurs canaux de publication – certains via des “publishers” privés –, nous nous sommes positionnés dans la fouille de données dans les sources pour les historiens, géographes… », raconte le chercheur à l’Inria, aujourd’hui à la tête de la direction de la culture et de l’information scientifiques depuis un peu plus d’un an. Pour le mathématicien Benoît Claudon, créer la revue Epiga – pour Épijournal de Géométrie Algébrique – en 2016 était également une occasion de donner l’exemple : « Nous voulions montrer aux collègues que cela existe et fonctionne », témoigne-t-il. D’autres créations suivirent, toujours principalement en maths, informatique et sciences humaines et sociales. À l’heure actuelle, 26 revues sont suivies par Episciences et plus de 5500 articles et comptes-rendu ont été publiés.
« Nous avons naïvement essayé de convaincre Springer de passer au modèle diamant »
Olivier Faugeras
Perte et fracas. Quelques créations de revues coïncident à de véritables claquages de porte chez des maisons d’édition privées, comme celle de la revue Mathematical Neuroscience and Applications, dont Olivier Faugeras est éditeur en chef. Son ancêtre était édité chez Springer depuis 2011 selon le modèle “gold” – en accès ouvert mais payant pour les auteurs – mais les frais de publication étaient de plus en plus compliqués à régler pour les auteurs. « Avec mon co-éditeur en chef, nous avons naïvement essayé de convaincre Springer de passer au modèle diamant [en accès ouvert et sans frais pour personne, NDLR]. Ce qu’ils ont bien sûr refusé », se souvient Olivier Faugeras. Ils décident donc de démissionner de concert et entraînent tous les éditeurs avec eux. « Springer n’a pas voulu céder les droits de la revue, nous n’avons donc pas pu garder le nom. Ils espéraient certainement qu’un des éditeurs accepterait de reprendre la suite, ce qu’aucun n’a fait », explique le mathématicien. La revue reprend donc du service sous un nouveau nom en 2021 chez Episciences, les archives de l’ancienne étant toujours hébergées par Springer. L’occasion pour les éditeurs en chef de revoir la ligne éditoriale de la revue, aujourd’hui plus tournée vers les mathématiques qu’auparavant.
« Notre ambition était de rassembler les communautés francophones qui utilisent un même outil »
Marion Maisonobe
Vivre libre. Si la volonté de s’affranchir des maisons d’édition transparaît dans chaque création de revue, certaines communautés évoquent des besoins bien spécifiques. C’est le cas des chercheurs à l’origine de l’Épijournal de Didactique et Epistémologie des Mathématiques pour l’Enseignement Supérieur (EpiDEMES) : « Nous voulions diffuser les résultats de la recherche en didactique aux praticiens [c’est-à-dire les enseignants du supérieur, NDLR], afin qu’ils puissent les appliquer sur le terrain, mais aussi rendre compte de leurs expériences », explique Hussein Sabra, co-fondateur de la revue. D’où l’importance d’une revue totalement gratuite et en open access. La revue était adossée à un groupement de recherche (GDR), tout comme ARCS – Analyse de réseaux en sciences sociales. « Dans le cadre du GDR, notre ambition était de rassembler les communautés francophones qui utilisent un même outil, l’analyse de réseau : sociologues, historiens, géographes… Le tout en créant de nouveaux supports de publication », raconte Marion Maisonobe, aujourd’hui co-directrice de la revue.
« Après discussion, ils se sont rendus compte que le double aveugle n’était pas nécessaire »
Céline Barthonnat
On boucle. Pour les auteurs, la soumission de manuscrits à des revues hébergées par Episciences – qui offre un logiciel de gestion éditorial – passe obligatoirement par un dépôt sur HAL, Zenodo ou arXiv. Une pratique qui peut surprendre certains chercheurs, ceux – notamment en sciences sociales – n’ayant pas toujours le réflexe du preprint ou ceux à l’international peu familiers avec la plateforme HAL. Mais après explications, la plupart jouent le jeu : « Personne n’a refusé de soumettre son manuscrit », témoigne Marion Maisonobe. La suite ressemble grandement au fonctionnement des revues traditionnelles, avec un comité éditorial qui se charge de trouver des reviewers et de récupérer les rapports.
Cécité partielle. Vu que le manuscrit est rendu public au moment de la soumission, impossible de réaliser une relecture en double aveugle – dans laquelle les auteurs sont anonymisés. Pour Céline Barthonnat, éditrice accompagnant les revues au sein d’Episciences, « cela peut demander de gros changements dans certaines communautés de sciences humaines et sociales ». Avec comme exemple celui de la revue Management et organisations du sport, dont les fondateurs craignaient que le comité éditorial refuse le principe du simple aveugle. « Finalement, après discussion, ils se sont rendu compte qu’ils se connaissaient tous et que le double aveugle n’était pas nécessaire », raconte Céline Barthonnat, formée en histoire avant de travailler dans l’édition scientifique.
« Un professionnel [de l’édition en freelance] va plus vite et le fait mieux. Nous avons eu des retours positifs des auteurs »
Benoît Claudon
Copi cent fôtes. Si le manuscrit est accepté, reste une dernière étape de mise en page et de relecture pour s’assurer de la lisibilité – et bien sûr de l’orthographe. C’est le “copy editing”, souvent réalisé par un secrétaire d’édition dans les revues de tailles conséquentes, dont l’impact sur le manuscrit varie d’une discipline à l’autre. En maths, les corrections sont minimes mais en sciences humaines et sociales, le secrétaire d’édition peut jouer un rôle crucial. Un travail qui peut donc vite devenir chronophage pour les chercheurs-éditeurs qui gèrent leurs propres revues – jusqu’à une dizaine d’heure par article. C’est pourquoi au-dessus d’un volume critique, certaines revues décident de payer les services de professionnels de l’édition en freelance, avec lesquels ils peuvent être mis en relation via Episciences. C’est souvent leur unique dépense, mais il faut la financer. Des financements existent, notamment via l’InSHS du CNRS – entre 1000 et 3000 euros par an –, le Fond national pour la science ouverte (FNSO) dont la troisième salve d’appel à projet est en cours d’évaluation ou encore des aides des universités. La revue Epiga a ainsi récolté plus de 15 000 euros sur trois ans, permettant ainsi de payer une freelance pour le copy editing et la mise en page des 25 articles qu’elle publie environ par an. « Un professionnel va plus vite et le fait mieux. Nous avons eu des retours positifs des auteurs », témoigne Benoît Claudon, co-fondateur de la revue.
« [L’absence de financement] est un choix discuté et fait en pleine conscience »
Laurent Romary
Jeu à somme nulle. Enfin, recevoir des fonds demande une structure juridique, impliquant souvent la gestion d’une association à laquelle la revue sera adossée. Pour éviter des complications administratives, lorsque les besoins sont encore restreints, beaucoup d’épirevues fonctionnent à budget nul – si l’on ne compte pas le salaire des chercheurs qui s’y consacrent, évidemment. Même après dix ans d’existence, la revue Journal of Data Mining and Digital Humanities reste sans financement, comme l’explique Laurent Romary qui en a fait un principe : « C’est un choix discuté et fait en pleine conscience avec l’équipe éditoriale. J’y suis attaché ». Dans les épirevues, presque tout est affaire de conviction.